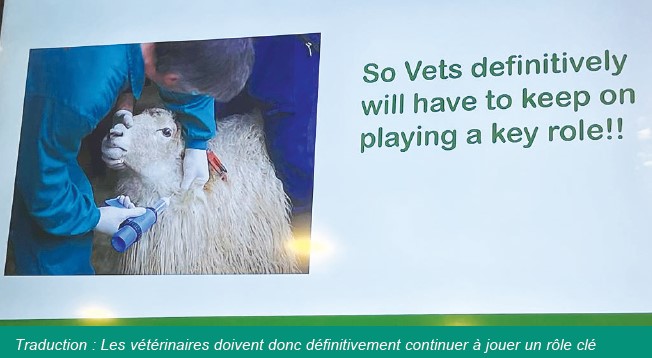- Par Silvia Carrio Durich
Travailler sur une vision globale de l’élevage Réduire l’empreinte carbone grâce à une meilleure santé du troupeau
Le 10ème congrès vétérinaire international ovin (ISVC) s’est tenu à Séville, du 6 au 10 mars 2023. Le programme, très riche, avec plus de 70 conférences et 300 communications orales organisées en 3 flux de sessions parallèles, a attiré plus de 600 congressistes. Il était bâti autour de sujets d’intérêt majeur pour le secteur ovin : durabilité de l’élevage ovin, lutte contre la résistance aux antimicrobiens, maîtrise sanitaire et conduite d’élevage. Dans un congrès aussi dense, il est difficile de faire un compte- rendu exhaustif sans faire catalogue. Aussi ai-je préféré orienter mon article sous l’angle des enjeux environnementaux de la filière ovine (diminution de l’empreinte carbone, réduction des intrants…).
Dans ce cadre, il convient de souligner une excellente conférence (Ignacio de Barbieri) sur la résilience des moutons. La résilience (capacité de l’animal à maintenir une performance de production adéquate dans des conditions difficiles ou à revenir à son état d’exposition antérieure au stress, sans conséquences durables, et à s’adapter rapidement aux fluctuations environnementales) est un point clé du volet durabilité de l’élevage ovin.
Parmi les stress majeurs, ont été cités les facteurs de stress climatiques (événements extrêmes de pluie, de sécheresse et de vagues de chaleur) qui impactent directement et défavorablement la production ovine. Le changement climatique affectera également la disponibilité et la qualité des ressources alimentaires. Les systèmes basés sur les parcours seront probablement plus fragilisés, avec une limitation de l’expression du potentiel de production ovin.
Autres stress : les maladies.
La maîtrise des maladies, notamment parasitaires, compte tenu des preuves croissantes de résistance aux médicaments, doit faire appel à des approches autres que le « tout médicament ».
Pour améliorer la résilience des moutons, la sélection génétique s’avère cruciale. Les caractéristiques liées à la productivité ont été incluses dans les programmes de sélection depuis de nombreuses années. Le volet « état corporel et mobilisation /reconstitution des réserves » est un caractère essentiel ; la variation de note d’état corporel est associée aux aptitudes de reproduction et donc constitue un indicateur de performance économique.
Le volet « résistance » aux maladies fait aussi partie des programmes de sélection. Une résistance génétique aux nématodes a été signalée dans le monde entier, avec une héritabilité faible à modérée et une co-sélection de moutons pour la résistance contre différents parasites serait possible.
Enfin, récemment, les caractéristiques d’efficacité alimentaire et d’émission de gaz à effet de serre ont été étudiées, et les paramètres génétiques pour les deux groupes de caractères ont été définis. Un des enjeux consiste maintenant au niveau de la sélection à tenir compte des antagonismes potentiels qui peuvent exister entre productivité et résilience.
Il a été aussi question dans ce congrès de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la production ovine.
Les petits ruminants génèrent des émissions de gaz à effet de serre (GES : méthane, protoxyde d’azote, dioxyde de carbone) représentant 7,4 % des GES mondiaux (FAO, 2017). L’empreinte carbone du lait de brebis et de la viande est plus du double par kg de produit que celle des bovins. Le conférencier espagnol (R. Ruiz Santos) a cité le projet européen LIFE GREEN SHEEP (2021-2025) comme élément structurant pour analyser l’effet des pratiques / systèmes sur l’empreinte carbone, arriver à réduire les émissions de carbone de 12 % sur cette période et améliorer la durabilité des troupeaux d’un point de vue tridimensionnel (social, économique et environnemental).
Sur ce dossier de l’empreinte carbone, il ne faut pas oublier l’importance d’avoir des animaux en bonne santé. Ainsi, une conférencière écossaise (N. Booth) est intervenue sur la quantification des effets du parasitisme sur les émissions de méthane d’agneau. Elle a cité une étude pilote mettant en évidence une augmentation de 33 % de ces émissions près du pic d’une infection par Teladorsagia circumcincta chez les agneaux parasités par rapport à des agneaux non parasités.
Face aux enjeux de réduction des intrants, notamment antibiotiques, il a été logiquement fait état de l’importance de la biosécurité et des plans à mettre en place dans les élevages. Dans les ateliers d’engraissement, rassemblant des agneaux d’origine multiple, avec la survenue de pneumonies, les conditions d’hébergement (densité, ventilation…) doivent être maîtrisées (J.M. Bello Dronda). Les paramètres environnementaux les plus pertinents liés aux maladies respiratoires étant la température, l’humidité relative et la concentration d’ammoniac, l’installation de capteurs d’ammoniac, de température, d’humidité et de CO2 et l’utilisation d’automates programmables pour réguler la ventilation mécanique s’avèrent des éléments d’aide essentiels. Il est important également de suivre des plans vaccinaux contre les pasteurelloses avec des vaccins permettant une protection croisée, utilisant des antigènes provenant d’isolats ovins (J.M. González Sáinz), en les ayant fait démarrer au moins 4 semaines avant la période à risque. La vaccination, comme moyen de diminuer le recours aux antibiotiques, a été également citée par la conférencière anglaise E Nabb, lors de son intervention sur le piétin. L’approche volontariste anglaise de pousser la vaccination des moutons pour répondre aux enjeux de l’avenir a été mise en avant : diminution de l’empreinte carbone grâce à une meilleure santé des animaux, bien-être animal, réduction des antibiotiques.



Dans les évolutions récentes de l’élevage ovin et des nouvelles technologies qui rendent plus pertinents notre approche du bien-être, de la santé, et plus globalement de la conduite d’un troupeau, il faut intégrer la chance d’avoir en Europe la très grande majorité des ovins identifiés électroniquement (e-ID). C’est une grande opportunité pour la mise en œuvre de l’élevage de précision par capteurs (G.Caja). Un travail ambitieux est mené actuellement sur ce sujet en Europe (https://techcare-project.eu/). Il vise à proposer-valider des approches innovantes et des modèles commerciaux appropriés pour surveiller les indicateurs de bien-être animal et améliorer la gestion du bien-être dans les systèmes de petits ruminants, utilisant des technologies d’élevage de précision (PLF) tout au long de la chaîne de production, permettant à toutes les parties prenantes, des agriculteurs aux consommateurs et aux régulateurs, de choisir des produits respectueux du bien-être animal.
A plus long terme, nous disposerons aussi d’autres atouts pour répondre aux objectifs de la filière ovine. Les connaissances dérivées du microbiome (somme des génomes des micro-organismes vivant dans ou sur un organisme animal, hors état pathologique) contribueront à une meilleure compréhension de la santé et de la production ovine et d’élaborer des stratégies visant à prévenir ou à traiter les maladies, à réduire les médicaments, à accroître la productivité (ou à la rendre plus durable) ou réduire l’impact environnemental de la production ovine (J.M Rodríguez).
Une des idées maîtresses de ce congrès, c’est de nous rebooster, nous vétérinaires et nous amener à réfléchir à l’intérêt d’une approche renouvelée de notre exercice de vétérinaire pour répondre aux enjeux de la filière ovine.
Il faut travailler sur une vision globale de l’élevage avec des objectifs et des indicateurs clairs concernant : santé, bien-être animal, productivité et résilience.
On pourra atteindre ces objectifs en appliquant le principe de la prévention et la programmation des traitements vaccinaux, antiparasitaires et autres moyens d’améliorer la réponse immunitaire des animaux face aux agents pathogènes.
Il faudra s‘appuyer sur les dernières études scientifiques permettant ainsi des techniques diverses ; plus classiques ou plus innovantes, qui permettront d’améliorer l’état de santé de nos troupeaux et de réduire l’utilisation d’antibiotiques ainsi que l’empreinte carbone.
Il nous appartient, nous vétérinaires, de continuer à bien accompagner les élevages dans toute leur intégrité, pour un avenir plus respectueux des animaux, de l’environnement ainsi que de nous-mêmes en tant que consommateur.